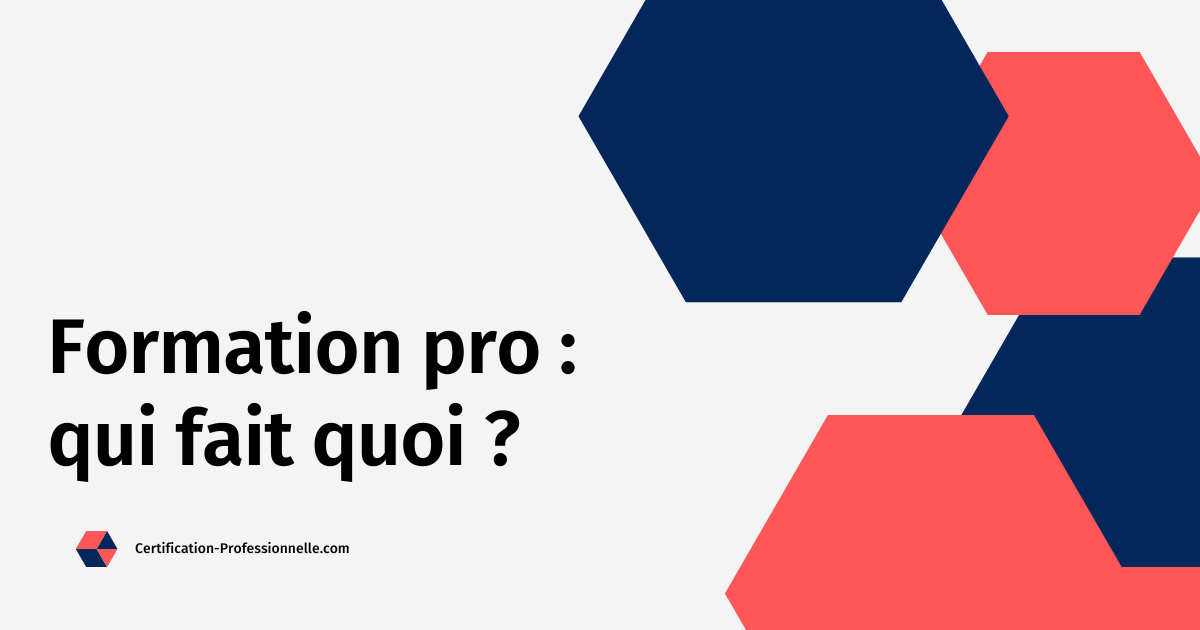Quand on regarde la formation professionnelle en France, on a vite l’impression d’un “terrain de jeu” remplis d’acteurs : État, France compétences, Régions, OPCO, CPF, entreprises, organismes de formation, certificateurs… Tout le monde semble important, mais il n’est pas toujours évident de comprendre qui fait quoi et comment ces rôles s’articulent quand on porte un projet de parcours certifiant.
L’objectif de cet article est justement de remettre de l’ordre dans ce paysage, en partant du point de vue d’un organisme de formation ou d’un futur certificateur qui veut bâtir une offre reconnue, finançable et lisible.
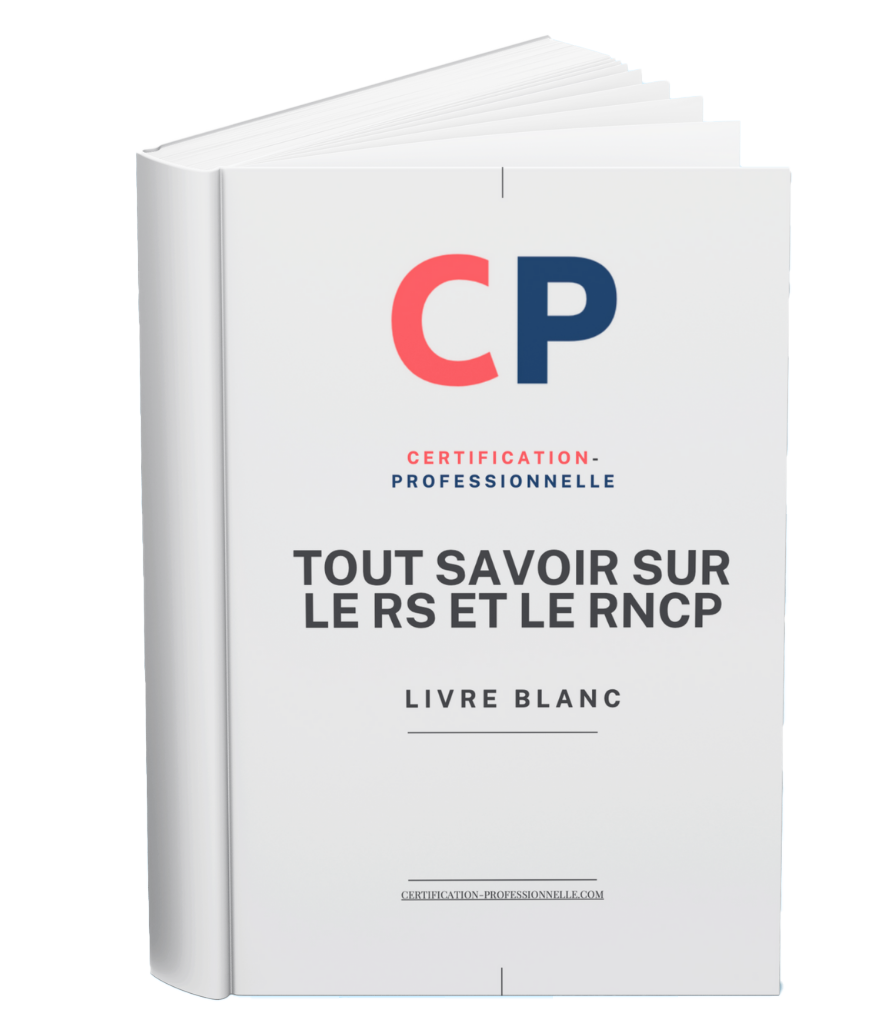
Téléchargez gratuitement votre guide RS / RNCP
Nous avons simplifié toutes les différences entre RS et RNCP dans un seul document. Utilisez-le comme support pour structurer votre offre ou monter un dossier France Compétences
1. Qui fixe le cadre ? L’État et France compétences
Au sommet, on trouve d’abord l’État, via le ministère du Travail. C’est lui qui pose le cadre légal de la formation professionnelle : grandes lois (par exemple la loi “Avenir professionnel”), droits des actifs, obligations des employeurs, définition des principaux dispositifs (CPF, alternance, etc.). Il s’assure aussi du bon usage des fonds publics et mutualisés et organise le contrôle des organismes de formation via les services déconcentrés (DREETS).
À côté de l’État, France compétences joue le rôle de gouvernance nationale. Créée par la réforme de 2018, cette institution est l’autorité de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Elle répartit les fonds entre les différents acteurs, régule la qualité et les coûts, et veille à l’adéquation des certifications avec les besoins du marché du travail.
Pour les porteurs de certifications, France compétences est surtout connue comme l’instance qui examine les dossiers d’enregistrement au RNCP et au Répertoire spécifique. C’est là que se jouent la reconnaissance officielle d’un titre et, très concrètement, sa possibilité d’être financé via des dispositifs comme le CPF.
2. Qui agit sur le terrain ? Régions, France Travail et acteurs de l’accompagnement
Une fois le cadre posé au niveau national, d’autres acteurs prennent le relais au plus près des publics.
Les Régions ont une responsabilité forte vis-à-vis des demandeurs d’emploi : elles financent une partie importante de leurs parcours de formation et construisent des plans régionaux d’investissement dans les compétences. Elles portent aussi des politiques spécifiques (apprentissage, filières prioritaires, métiers en tension, etc.).
À leurs côtés, France Travail (ex-Pôle emploi), les Missions locales, Cap emploi ou encore les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle (CEP) jouent un rôle d’orientation. Ils accompagnent les personnes dans la définition de leur projet, identifient les formations pertinentes et mobilisent les bons financements.
Pour un organisme de formation, ces acteurs sont à la fois des prescripteurs (ils orientent les publics vers des sessions) et des partenaires de terrain. Travailler avec eux, c’est souvent adapter ses parcours à des besoins très concrets : reconversion, montée en compétences rapide, remise à niveau, etc.
3. Qui finance les parcours ? CPF, OPCO et entreprises
Au cœur du dispositif, il y a ensuite la question du financement.
Le Compte personnel de formation (CPF) donne à chaque actif un droit à la formation qu’il peut mobiliser tout au long de sa vie professionnelle. La Caisse des dépôts assure la gestion opérationnelle de la plateforme “Mon Compte Formation”, tandis que France compétences en fixe les grandes règles de prise en charge.
Côté entreprises, ce sont désormais les OPCO (opérateurs de compétences) qui les accompagnent. Ils ne se contentent pas de redistribuer des fonds : ils conseillent les TPE-PME, financent les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, soutiennent certains projets de développement des compétences et participent à la construction de référentiels de branche.
Enfin, il ne faut pas oublier le rôle direct des employeurs. Ce sont eux qui identifient leurs besoins de compétences, arbitrent les budgets, choisissent les prestataires et, de plus en plus, co-construisent les parcours avec les organismes de formation. Dans les faits, beaucoup de projets naissent d’un dialogue très opérationnel entre une entreprise et un OF : analyse du besoin, construction d’un bloc de compétences, modalités d’évaluation, articulation avec le travail réel.
Pour un organisme de formation, comprendre cette mécanique, c’est savoir à qui parler : à un OPCO pour vérifier les prises en charge, à un employeur pour ajuster un programme, à la Caisse des dépôts pour les aspects CPF, etc.
4. Qui conçoit les formations ? Organismes de formation et certificateurs
Au centre du système, on retrouve les organismes de formation. Ce sont eux qui conçoivent les parcours, formalisent les objectifs, choisissent les modalités (présentiel, distanciel, AFEST, blended…), organisent les évaluations et accompagnent les apprenants tout au long de l’action.
Depuis l’entrée en vigueur de Qualiopi, leur responsabilité va plus loin : ils doivent démontrer la qualité de leurs processus, suivre leurs résultats, traiter les réclamations, s’inscrire dans une logique d’amélioration continue. La question n’est plus seulement “faire une bonne formation”, mais prouver la qualité et la performance du dispositif auprès des financeurs et des autorités.
Face à eux, mais souvent en partenariat avec eux, se trouvent les organismes certificateurs. Ce sont ceux qui portent officiellement les certifications enregistrées au RNCP ou au Répertoire spécifique : ministères, branches professionnelles, écoles, universités, réseaux d’OF, etc. Ils définissent le référentiel de compétences, les modalités d’évaluation et les conditions d’obtention. Ils assurent la vie de la certification : suivi des résultats, mises à jour, demandes de renouvellement devant France compétences.
Un organisme de formation peut lui-même être certificateur, ou bien agir comme partenaire d’un certificateur. Dans ce second cas, il prépare les candidats à une certification existante dans le cadre d’une convention, en respectant le référentiel et les exigences définies.
5. Comment se positionner dans cet écosystème ?
Vu de loin, tout cela peut ressembler à une cartographie complexe. Vu de près, chaque acteur a pourtant une place assez claire :
- l’État et France compétences fixent le cadre et régulent ;
- les Régions, France Travail et le CEP travaillent avec les publics et pilotent des dispositifs sur le terrain ;
- les OPCO, le CPF et les entreprises assurent le financement ;
- les organismes de formation conçoivent et délivrent les parcours ;
- les certificateurs garantissent la reconnaissance officielle des compétences.
Pour un organisme de formation qui souhaite aller vers la certification de ses parcours, l’enjeu est de traduire cette cartographie dans un projet concret : choisir le bon registre (RNCP ou Répertoire spécifique), structurer ses blocs de compétences, définir les modalités d’évaluation, organiser la relation avec le certificateur ou devenir certificateur soi-même.
C’est précisément sur ce point que Certification-professionnelle.com intervient : en aidant les OF à passer d’une offre de formation “classique” à de véritables parcours certifiants, alignés avec les attentes de France compétences, lisibles pour les financeurs et utiles pour les apprenants. Comprendre qui fait quoi est une première étape ; construire un dossier solide et une ingénierie de certification robuste est la suivante.