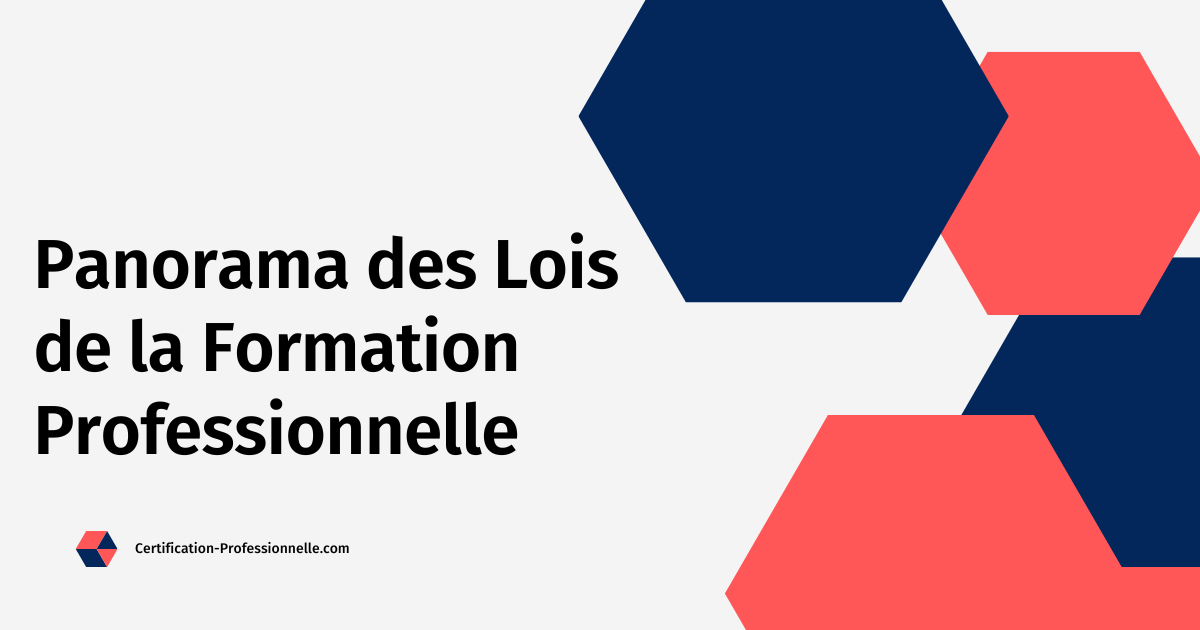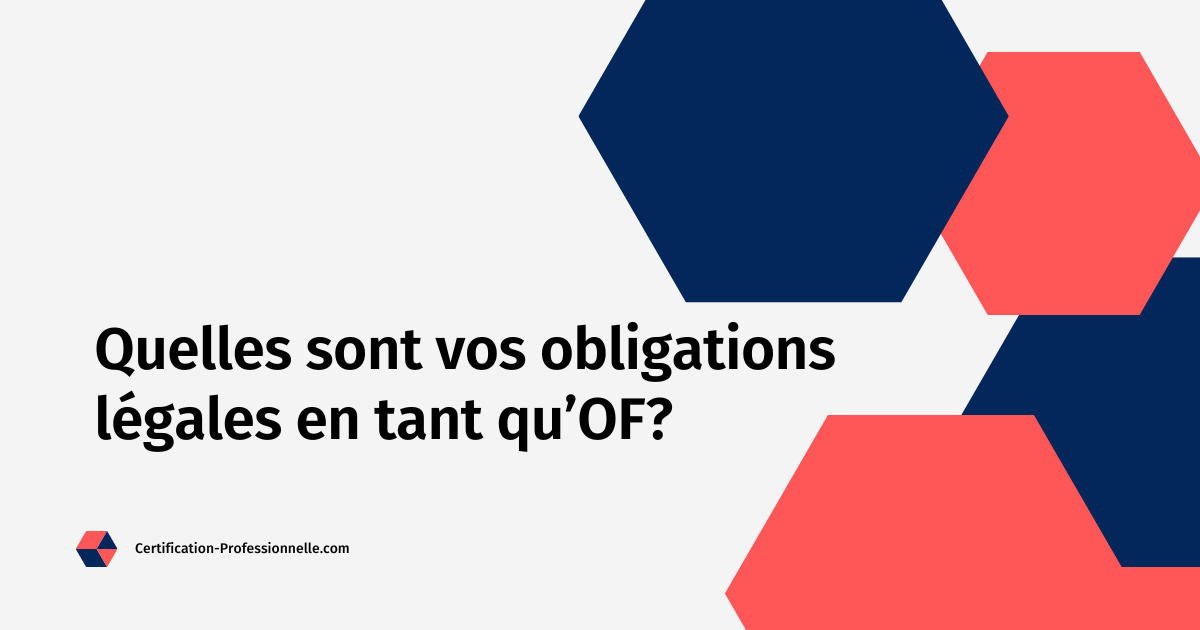La formation professionnelle en France a connu une succession de réformes législatives majeures depuis les années 1970. Chaque loi a élargi le droit à la formation, redéfini les obligations des entreprises et adapté le dispositif aux évolutions économiques et sociales. L’ensemble de ces réformes vise à encourager le développement des compétences, sécuriser les parcours professionnels et renforcer la compétitivité des entreprises. Voici les étapes clés de cette histoire législative.
1971 (Loi Delors) : les bases de la formation continue
La loi du 16 juillet 1971 (dite loi Delors) pose les fondations de la formation professionnelle continue en France. Elle reconnaît pour la première fois le droit de tout salarié à se former tout au long de la vie et institue des congés formation rémunérés. Surtout, elle impose aux entreprises d’au moins 10 salariés de financer la formation de leurs employés par une contribution obligatoire. Ce mécanisme (déclaré ensuite chaque année aux impôts) a suscité le financement massif de stages de développement des compétences, ouvrant la voie à l’offre de formation professionnelle telle que nous la connaissons aujourd’hui.
2002 (Loi de modernisation sociale) : plus de droits individuels
Plus de 30 ans plus tard, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale renforce les droits individuels en matière de formation. Elle crée notamment le bilan de compétences et le congé individuel de formation (CIF). Le bilan de compétences permet au salarié de faire le point sur son parcours et ses aspirations, tandis que le CIF l’autorise à s’absenter de son poste (avec maintien de salaire) pour suivre une formation généralement longue en vue d’une reconversion ou d’une montée en compétences. Cette loi marque ainsi un tournant vers une plus grande autonomie des salariés et une protection accrue de leur droit à la formation, en sus des obligations faites aux entreprises.
2005 (Loi de cohésion sociale) : insertion et alternance
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) vise à faciliter l’insertion des jeunes et demandeurs d’emploi. Elle instaure notamment le contrat de professionnalisation, un dispositif d’alternance mêlant travail en entreprise et formation, destiné aux 16–25 ans mais aussi aux adultes peu qualifiés. Ce contrat permet d’acquérir un diplôme ou une certification tout en travaillant, en s’appuyant sur une aide financière versée aux entreprises. La loi de 2005 a ainsi renforcé la formation comme levier d’insertion professionnelle, en encourageant les publics éloignés de l’emploi à se former en entreprise.
2009 : « formation tout au long de la vie » et sécurisation des parcours
La loi du 24 novembre 2009 consacre l’idée de la formation comme levier permanent de progression professionnelle. Elle consacre « le droit à la formation tout au long de la vie », face à des métiers qui évoluent sans cesse. Elle crée aussi le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), chargé de financer des formations pour les salariés en reconversion, les jeunes non qualifiés ou les demandeurs d’emploi. Par ailleurs, la loi renforce le droit individuel à la formation (DIF) en introduisant sa portabilité d’une entreprise à l’autre, et étend le contrat de professionnalisation aux publics les plus fragiles. L’objectif global est de sécuriser les parcours professionnels en maintenant les salariés actifs et qualifiés, en s’appuyant sur un financement mutualisé entre entreprises, État et partenaires sociaux.
2014 : le Compte Personnel de Formation et de nouvelles institutions
La loi du 5 mars 2014 (formation professionnelle, emploi et démocratie sociale) est marquée par une simplification majeure : elle crée le Compte Personnel de Formation (CPF), destiné à remplacer à terme le DIF. Le CPF est un compte individuel attaché à chaque actif (salarié ou demandeur d’emploi) qui cumule des droits à la formation. Le CPF permet à chacun de choisir librement ses formations certifiantes.
Cette loi introduit également plusieurs mesures phares :
- Création du CPF universel (remplaçant le DIF) pour financer des formations certifiantes.
- Mise en place du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), un service gratuit d’accompagnement pour tout actif.
- Instauration d’une contribution unique des entreprises (suppression de l’obligation de justifier fiscalement le plan de formation) afin de simplifier le financement.
- Introduction de l’entretien professionnel obligatoire tous les deux ans pour suivre le parcours de chaque salarié.
- Insistance sur la qualité des formations dispensées.
- Création du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) et mise en place d’une gouvernance quadripartite (État, Régions, syndicats et patronat) au niveau national et régional.
Ces mesures visaient à responsabiliser les individus dans leur parcours, améliorer la transparence financière et garantir des formations certifiantes et de qualité.
2016 (Loi Travail) : certification qualité et comptes élargis
La loi du 8 août 2016 (dite Loi Travail ou loi El Khomri) n’est pas une réforme centrée sur la formation, mais elle comporte un volet formation important. Elle introduit les comptes personnels d’activité (CPA), incluant le CPF (ouvert aux indépendants), le Compte Personnel de Prévention (pour pénibilité), et le Compte d’Engagement Citoyen. Elle renforce aussi le CEP et impose aux organismes de formation une obligation d’information.
Surtout, la loi 2016 introduit la notion de certification qualité des organismes de formation pour accéder aux fonds publics. Elle impose que les organismes de formation soient certifiés pour accéder aux financements publics, incitant ainsi les prestataires à respecter des standards de qualité. Cette démarche aboutira au référentiel Qualiopi (devenu obligatoire en 2022) qui exige des OF qu’ils démontrent la qualité de leurs processus pédagogiques.
2018 Loi « Avenir professionnel » : modernisation et digitalisation
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (pour la liberté de choisir son avenir professionnel) constitue une réforme d’ampleur qui a transformé en profondeur la formation professionnelle. Ses principaux axes sont :
- Qualiopi obligatoire : elle rendait obligatoire, dès son entrée en vigueur, la certification Qualiopi pour tous les organismes souhaitant bénéficier de financements publics ou mutualisés;
- Monétisation du CPF : la loi généralise le CPF en le transformant en compte crédité en euros, permettant ainsi à chaque actif d’acheter en ligne la formation de son choix.
- Création des OPCO : la loi remplace les anciens OPCA par les Opérateurs de Compétences (OPCO), dont la mission est recentrée sur le financement des alternances et l’accompagnement des entreprises dans la gestion prévisionnelle des compétences.
- Amélioration de l’apprentissage : la réforme libéralise le marché de l’apprentissage (nouveau cadre contractuel, contrats simplifiés), introduit le dispositif Pro A (reconversion via formation en alternance), et assouplit les seuils pour encourager l’embauche d’apprentis.
- Création de France Compétences : enfin, la loi crée l’établissement public national France compétences, chargé de réguler et financer l’ensemble du système de formation et d’apprentissage. France compétences répartit les fonds mutualisés, valide les certifications inscrites au RNCP/RS et évalue la qualité du système de formation (missions de régulation et de financement).
Aujourd’hui, le paysage de la formation professionnelle repose sur ce cadre consolidé : droit renforcé des individus à se former (CPF/CEP), qualité exigée des organismes (RNQ/Qualiopi) et gouvernance unifiée (France Compétences). Les organismes de formation doivent s’adapter à ces évolutions – par exemple en obtenant la certification Qualiopi et en inscrivant leurs parcours au RNCP/RS – pour assurer leur conformité et bénéficier des financements publics. Ce panorama législatif montre que, depuis 1971, la France a progressivement consolidé un droit à la formation tout au long de la vie, intégrant à chaque étape de nouvelles garanties pour les salariés et une responsabilité accrue des acteurs.